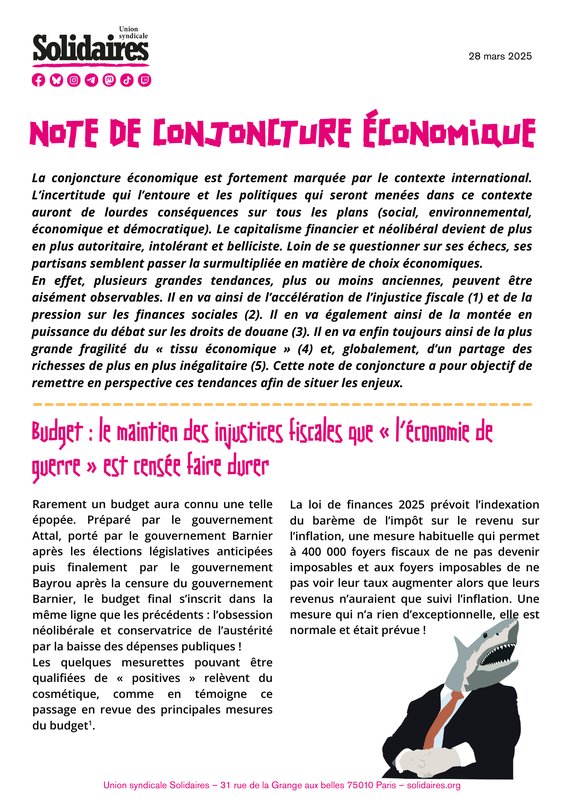La conjoncture économique est fortement marquée par le contexte international. L’incertitude qui l’entoure et les politiques qui seront menées dans ce contexte auront de lourdes conséquences sur tous les plans (social, environnemental, économique et démocratique). Le capitalisme financier et néolibéral devient de plus en plus autoritaire, intolérant et belliciste. Loin de se questionner sur ses échecs, ses partisans semblent passer la surmultipliée en matière de choix économiques.
En effet, plusieurs grandes tendances, plus ou moins anciennes, peuvent être aisément observables. Il en va ainsi de l’accélération de l’injustice fiscale (1) et de la pression sur les finances sociales (2). Il en va également ainsi de la montée en puissance du débat sur les droits de douane (3). Il en va enfin toujours ainsi de la plus grande fragilité du « tissu économique » (4) et, globalement, d’un partage des richesses de plus en plus inégalitaire (5). Cette note de conjoncture a pour objectif de remettre en perspective ces tendances afin de situer les enjeux.
Budget : le maintien des injustices fiscales que « l’économie de guerre » est censée faire durer
Rarement un budget aura connu une telle épopée. Préparé par le gouvernement Attal, porté par le gouvernement Barnier après les élections législatives anticipées puis finalement par le gouvernement Bayrou après la censure du gouvernement Barnier, le budget final s’inscrit dans la même ligne que les précédents : l’obsession néolibérale et conservatrice de l’austérité par la baisse des dépenses publiques ! Les quelques mesurettes pouvant être qualifiées de « positives » relèvent du cosmétique, comme en témoigne ce passage en revue des principales mesures du budget1.
La loi de finances 2025 prévoit l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation, une mesure habituelle qui permet à 400 000 foyers fiscaux de ne pas devenir imposables et aux foyers imposables de ne pas voir leur taux augmenter alors que leurs revenus n’auraient que suivi l’inflation. Une mesure qui n’a rien d’exceptionnelle, elle est normale et était prévue !
Un taux minimum d’imposition du revenu de 20 %, déjà prévue par le gouvernement Barnier, dite « contribution sur les plus aisés », concernera les foyers très aisés (ceux percevant plus de 250 000 euros par an pour une personne seule ou plus de 500 000 pour un couple). Cette « contribution différentielle » reste temporaire et doit rapporter 2 milliards d’euros. Son rendement a été discuté car les données de l’administration fiscale indiquent plutôt un rendement inférieur à 1 milliard d’euros. Cette contribution est temporaire, elle ne s’appliquera que deux ans.
Le texte prévoit une surtaxe sur l’impôt des plus grandes sociétés pour un rendement attendu de 8 milliards d’euros. Elle ne s’appliquera toutefois qu’en 2025, contre deux ans dans le projet de budget Barnier. Cette contribution a été fortement critiquée par les grands patrons et notamment par Bernard Arnault. Ils auront oublié de dire que l’imposition des entreprises n’a jamais été aussi faible en France et que leurs profits, comme leurs distributions de dividendes, atteignent toujours des niveaux record. Les 400 plus grandes entreprises ne paieront une « surtaxe » qu'un an !
Plusieurs taxes ont été revues à la hausse comme celle de solidarité sur les billets d’avion (pour 800 millions d’euros), tandis qu’en matière de fiscalité environnementale, sont prévus un renforcement du malus sur les achats de véhicules thermiques et la hausse des taxes sur les chaudières à gaz. Enfin, le taux de la taxe sur les transactions financières a été relevé de 0,3 à 0,4 % pour un rendement supplémentaire qu’on peut estimer entre 400 à 500 millions d’euros. Mais l’immense majorité des transactions financières n’y sera pas soumise, les activités les plus spéculatives n’étant toujours pas taxées (le « infra day à haute fréquence »).
Le budget Bayrou ressemble au budget Barnier. Il est même en recul puisque la surtaxe des plus grandes entreprises ne s’appliquera qu’un an au lieu de deux dans le projet « Barnier ». Bernard Arnault et les grands patrons ont obtenu satisfaction sur leurs revendications : maintenir leurs acquis fiscaux et éviter toute mesure de justice fiscale. Celle-ci attendra… L’évolution récente du discours sur le nécessaire financement d’une « économie de guerre » est alarmante. Au-delà des drames que tout conflit provoque, le pouvoir et les « puissants » unissent une fois de plus leurs voix pour demander une réduction des dépenses liées à la protection sociale et aux services publics afin de revaloriser le budget de la défense. Mais sans mettre pour autant davantage les riches et les multinationales à contribution. Le comble du cynisme.
►Repères revendicatifs
Pour l’Union syndicale Solidaires, rien dans ces mesures ne correspond aux enjeux en matière de financement de la bifurcation sociale et écologique et de réduction des inégalités de toutes sortes, que seule une véritable réforme fiscale de fond permettrait grâce notamment à :
- l’instauration d’un véritable impôt sur la fortune
- une taxation des superprofits,
- une taxation des rachats d’actions,
- l’arrêt de la baisse des impôts « de production »,
- la suppression du prélèvement forfaitaire unique et l’imposition des revenus financiers au barème progressif de l’impôt sur le revenu,
- une taxe sur toutes les transactions financières incluant le trading à haute fréquence,
- une meilleure imposition de la transmission des patrimoines les plus importants,
- une revue des niches fiscales pour supprimer celles qui sont injustes et inefficaces,
- un renforcement de l’ensemble des moyens dédiés à la lutte contre l’évasion fiscale.
Financer la protection sociale et les retraites, possible et souhaitable !
En déclarant que l’âge légal de départ à la retraite ne serait pas abaissé à 62 ans, François Bayrou a tombé le masque. Il avait vanté son « conclave » afin que les « partenaires sociaux » se mettent d’accord. Il a pris une décision unilatérale sur un sujet pourtant central. Disons-le, de « dialogue social » selon la formule consacrée, il n‘a jamais été question avec ce pouvoir. Cet épisode le démontre une fois de plus.
François Bayrou avait déjà instrumentalisé et dramatisé la question du financement du système de retraite, en évoquant un déficit de 45 à 55 milliards d’euros d’ici 2030. Mais la Cour des comptes elle-même lui avait donné tort en estimant ce déficit à moins de 7 milliards d’euros, un montant à rapporter aux dépenses de retraites totales (environ 355 milliards d’euros en 2022). Comme ses prédécesseurs, le premier ministre a donc fait le choix de la régression sociale malgré l’évidence : il est possible de financer un système de retraite dans lequel l'âge de départ légal ET le nombre d’annuités permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein seraient sensiblement abaissés.
Pour cela, il faut se pencher sur le coût exorbitant des allègements de cotisations sociales et leurs résultats. Les allègements de cotisations sociales auraient représenté un coût de 89,7 milliards d’euros en 2024 et dépasseraient les 91 milliards d’euros en 20252. Depuis 1993, les différentes vagues d’allègements de cotisation sociales se traduisent par une baisse du « coût » du travail. Pour leurs promoteurs, celle-ci est censée d’une part, réduire le prix final, ce qui favoriserait les exportations notamment et d’autre part, favoriser les embauches ou le maintien en emploi, ce qui ferait baisser le chômage.
Mais il y a bien loin de la théorie à la réalité. Les différentes études menées de l’Institut des Politiques Publiques ou encore du Conseil d’Analyse économique montrent en effet que ces allègements n’ont que peu d’effets3. Un rapport de France stratégie, pourtant relativement peu critique sur la politique de baisse du « coût » du travail, plaide également pour une « inflexion »4. Les baisses de cotisations sociales ne sont en effet pas toutes répercutées dans les prix : elles alimentent également les profits… Par ailleurs, elles génèrent des effets d’aubaine (certaines entreprises n’en ayant pas besoin en bénéficient) et pervers (elles maintiennent de nombreux/ses salarié·es sous les seuils d’exonération).
►Repères revendicatifs
L’Union syndicale revendique le remboursement des aides publiques versées et des exonérations, ainsi que le reversement du montant des dividendes aux salarié-es licencié-es, lors de fermetures d’usines. Plus généralement, le suivi et le contrôle de toutes les aides publiques accordées aux entreprises. L’objectif est de conditionner les aides publiques, ce qui ferait notamment fortement baisser le manque à gagner provoqué par les allègements de cotisations sociales. Le rendement budgétaire supplémentaire qui serait dégagé permettrait de financer une véritable réforme des systèmes de retraites et, plus globalement, l’ensemble de la Sécurité sociale.
Droits de douane, Trump déclare la guerre commerciale
En matière de droits de douane, Donald Trump mène une offensive générale aux relents nationalo-protectionnistes et impérialistes qui ouvre une nouvelle ère dans la guerre économique mondiale. Plusieurs pays comme le Canada ou le Mexique sont visés, mais également l’Union européenne. Le 12 mars, il a annoncé imposer de nouveaux droits de douane de 25 % sur tous les produits importés en acier et en aluminium. En réponse, la Commission européenne a annoncé qu’elle appliquerait à son tour des droits de douane « forts mais proportionnés » sur une série de produits américains à compter du 1er avril. De son côté, le Canada a également décidé de mettre en place des droits de douane de 25 % sur des produits américains.
Les annonces de Donald Trump auront des conséquences dans tous les pays. La baisse de certaines exportations vers les États-Unis pénalisera les pays concernés (les producteurs de voitures en Allemagne… dont Tesla, ou de vins en France par exemple), tandis que les consommateurs américains seront pénalisés par le relèvement des prix, puisque les États-Unis devront tout de même continuer d’importer ce qu’ils ne produisent pas ou ne produisant pas en assez grande quantité. Les économies étant imbriquées, cette politique perturbera fortement les chaînes de valeur y compris aux Etats-Unis. La Banque de France estime qu'une hausse des droits de douane de 25 points de pourcentage pourrait diminuer le PIB de la zone euro de 0,3 % environ au bout d'un à deux ans. La stratégie de Donald Trump consiste à dégager des marges de manœuvre budgétaires grâce aux relèvements des droits de douane (qui ne représentent que 1,8 % des recettes fédérales), sans doute pour poursuivre une politique fiscale particulièrement injuste, et peser dans le rapport de force entre pays en les divisant, ceux-ci n’ayant pas les mêmes intérêts commerciaux, afin d‘obtenir d’autres avancées pour les Etats-Unis. C’est un jeu « perdant perdant ».
►Repères revendicatifs
Pour l’Union syndicale Solidaires, cette guerre commerciale illustre la nocivité d’un système fondé sur la guerre économique et le libre échange sans régulation sociale et écologique. De manière générale, il faut donc limiter la liberté de circulation des capitaux pour éviter les délocalisations qui ne feraient que déplacer et intensifier les problèmes écologiques dans les pays émergents et pour réduire l’empreinte écologique des pays développés. L’un des enjeux consiste en la relocalisation d’activités, des productions agricoles par exemple, avec le maintien d’une agriculture paysanne plus sobre en transport et intrants et plus créatrice d’emplois.
Par ailleurs, la valeur des marchandises importées doit intégrer, lors de leur déclaration en douane, tous les éléments de cette facture écologique, à commencer par les coûts de transport internationaux dont la valeur marchande est aujourd’hui scandaleusement minorée par rapport à la valeur réelle. Il en est de même pour le respect des normes sociales. Par ailleurs, il s'agit de prendre en compte les coûts réels des flux entre entités des firmes multinationales au lieu et place de leurs prix de transfert fortement minorés. Globalement,il s’agit de renforcer la coopération en lieu et place de la guerre économique.
Créations d’entreprises : entre faux record et vraies défaillances
Si la période actuelle est fragile, au cours des dernières années, on a périodiquement entendu les pouvoirs publics se vanter du nombre de créations d’entreprises. Entre 2000 et 2022, le nombre annuel de créations d’entreprise a effectivement été multiplié par plus de quatre, passant de 238 000 à 1 066 000 entreprises5. Pour certains, cela démontre l’efficacité des politiques de l’offre. En réalité, cette hausse s’explique principalement par la création en 2008 du statut d’auto-entrepreneur. Selon l'Insee, le nombre d'entreprises créées en France au cours de l'année 2024 a atteint un niveau record de 1 111 238, contre 1 051 476 en 2023, soit une hausse de 5,7 %. Les créations d'entreprises sous le régime de micro entreprises6 ont fortement progressé (+ 7,3 %) pour s'établir à 716 194, contre 667 446 en 2023. Elles ont représenté à elles seules près des deux tiers (64,5 %) de l'ensemble des créations d'entreprises. Certes, les autres formes d’entreprises ont également vu leur nombre s’accroître, mais dans des proportions plus faibles.
Ce prétendu record en cache un autre. En 2024, le nombre de défaillances d’entreprises s’est élevé à 67 830. Un niveau record inédit depuis la crise financière de 2009. Les défaillances ont ainsi progressé de 17 % sur un an. Et depuis le début de l’année 2025, le nombre de créations d’entreprises marque le pas.
L’uberisation de l’économie n’est donc pas un mythe. De plus en plus de personnes se déclarent auto-entrepreneurs/euses faute de pouvoir accéder à un emploi de salarié ou pour compléter leur revenu. Selon l’INSEE, en 2022, les micro-entrepreneurs perçoivent en moyenne 670 euros par mois pour leur activité non salariée, soit six fois moins que les non salarié·es classiques7. Leur faible revenu est lié à la nature de ce régime qui impose des plafonds sur les chiffres d’affaires pour en bénéficier. En 2022, parmi les micro -entrepreneurs/euses déclarant un revenu (certain·es ont des revenus nuls), un·e sur quatre gagne moins de 90 euros par mois, un·e sur deux moins de 340 euros, et un·e sur dix plus de 1 750 euros. Pour une grande partie des auto entrepreneurs/euses, il s’agit d’une activité d’appoint. Les autres n’ont guère le choix : s’ils et elles veulent travailler, l’autoentreprise s’impose à elles.
L’esprit d’entreprise doit être relativisé, l’analyse des « records » de créations également. En réalité, la tendance à l’œuvre est nette : l’emploi non salarié évolue plus vite que l’emploi salarié. Entre les années 2000 et 2023 dans le secteur privé, le nombre d’emplois non salarié est passé de 2,22 millions de personnes à plus de 3,33 millions, soit une hausse de près de 52 % tandis que le nombre d’emplois de salariés est passé de 22,89 millions à un peu plus de 27 millions, soit une hausse de 18 %8.
►Repères revendicatifs
Pour l’Union syndicale Solidaires, outre les revendications sur la hausse des salaires, une réelle égalité femmes/hommes, une forte réduction des inégalités de revenus ou la création de nouveaux droits pour les salarié·es, en matière d’emploi, le CDI à temps plein comme norme dans le secteur privé. La lutte contre le chômage et la précarité dans l’emploi est prioritaire. Le statut d'auto-entrepreneur nourrit la précarité mais également les inégalités. Il faut y mettre un terme notamment par la présomption de salariat pour les travailleurs-ses de plateforme numérique.
Il faut aussi une réelle égalité des droits sociaux entre travailleur-se-s de l’entreprise ou de l’administration et ceux/celles de la sous-traitance. La sous-traitance doit être limitée aux travaux qui revêtent un caractère exceptionnel et à deux niveaux au maximum (un seul dans le BTP) et son interdiction totale pour tous les travaux dangereux ou insalubres. Il faut enfin interdire pour une entreprise d’avoir recours à des micro-entrepreneurs-euses ou à de la sous-traitance pour effectuer les activités réalisables par les salarié-es de l’entreprise et des administrations. Le réduction du temps de travail, le respect de la hiérarchie des normes (s’agissant notamment du droit du travail) et une harmonisation des conventions de branche par le haut sont également des moyens de sécuriser l’emploi.
Mieux partager les richesses, un enjeu capital….
Le constat est solidement établi : depuis les années 1980, le part de la richesse allouée au travail (notamment aux salaires) diminue au profit de la part allouée au capital9. En clair, le part de la valeur se déforme pour le plus grand profit des opérations financières et au détriment de l’immense majorité des salarié·es. Il s’agit d’une tendance de long terme que l’on observe dans de nombreux pays. Le Conseil d’analyse économique note lui-même « le déclin récent de la part du travail dans la plupart des pays de l’OCDE et le rôle majeur des politiques qui affectent les revenus primaires et nourrissent la dynamique des inégalités ».
Au sein de la part allouée au travail, les inégalités s’accroissent au profit des plus aisé·es. En France, au début des années 1980, les 1% les plus riches captaient ainsi environ 7,5 % du revenu national, contre pratiquement 10 % à la fin des années 2010. Le revenu des 50 % les plus pauvres dans le revenu national a en revanche stagné aux alentours de 22 %10. Une étude récente a montré que, sur une vingtaine d’années (de 2003 à 2022), l’étude observe une augmentation plus rapide des revenus pour les foyers à très hauts revenus que pour les autres foyers (+119 % contre +46 %). Le patrimoine moyen de ces foyers a pour sa part presque doublé sur la période 2003 et 2016 (de 5,2 milliards d’euros à 10,2 milliards d’euros) avec une progression moyenne annuelle plus élevée que les autres foyers (+5,4 % contre +4,2 %)11.
Entre spécialistes, le débat sur les facteurs pouvant expliquer cette situation fait rage. Pour certains, le progrès technique en est l’un des principaux. Le progrès technologique ferait baisser le prix de l'investissement par rapport aux prix à la consommation. Les entreprises seraient donc incitées à remplacer du travail par du capital. Une explication supplémentaire résiderait dans la part croissante, dans la production, des actifs immatériels (brevets, recherche et développement, etc) qui participeraient à la plus forte accumulation du capital, des entreprises comme Sanofi se séparant ainsi de leurs sites de production. Notons que les mêmes refusent cependant d’en tirer la conclusion selon laquelle il faudrait réduire le temps de travail.
Si la technologie de l’économie et le développement des actifs immatériels dans la comptabilité est une réalité, il faut être plus nuancé (en fonction des secteurs, les situations varient) et objectif : cette situation résulte également de la financiarisation de l’économie et la captation d’une part toujours croissante de la richesse par une minorité d'ultra riches. L'augmentation de la part des revenus du capital dans la valeur ajoutée s'explique en réalité surtout par une augmentation de la part des profits. Et tout cela, alors que le taux de pauvreté se maintient à plus de 14 % de la population, soit à un niveau historiquement élevé depuis plusieurs années en France12. Enfin, l’intense concurrence internationale favorisée par la déréglementation incite à la délocalisation de parties entières des chaînes de production intensives en main d'œuvre. La baisse du pouvoir de négociation des salariés pèse également sur les salaires.
►Repères revendicatifs
Pour l’Union syndicale Solidaires, pour réduire les inégalités de revenus, il faut jouer sur plusieurs facteurs : restaurer un partage entre salaires et profits ; faire reculer la précarité ; réduire la ponction de la finance et réaliser une profonde réforme fiscale. Cela permettrait un transfert des revenus financiers vers les revenus du travail : plus de salaires, moins de dividendes.
Au-delà des revendications immédiates sur les augmentations des salaires, des minimas sociaux, des pensions de retraite et du SMIC, il est essentiel de remettre au centre la question fondamentale du partage entre salaire et profit. Ce partage inclut d’ailleurs la part du salaire direct et la part socialisée des cotisations sociales qui financent la Sécurité sociale mais également la redistribution via les services publics via la fiscalité. La place des organisations syndicales doit également être mieux reconnue, ce qui suppose d'en finir avec leur stigmatisation et, parfois, la répression anti-syndicale, de reconnaître pleinement le rôle des délégué·es syndicaux/ales notamment. Plus globalement, une plus juste répartition des richesses doit permettre de réduire fortement les inégalités et de prendre en charge les biens communs, en finançant mieux notamment le système de protection sociale et les services publics.
Notes de bas de pages
1 Loi du 14 février de finances pour 2025.
2 Rapport à la commission des comptes de la Sécurité sociale, résultats 2023 , prévisions 2024 et 2025, octobre 2024.
3Yannlck L'Horty. Philippe Martin et Thierry Mayer, « Baisses de charges : stop ou encore ? ». Notes du CAE n•49.1anvier 2019. Clément Malgouyres, « Coût du travail et exportations : analyses sur données d'entreprises », Rapport IPP n• 20. janvier 2019.
4 Antoine Bozio et Etienne Wasmer, « Les politiques d’exonérations sociales : une inflexion nécessaire », France Stratégie, octobre 2024.
5 France Stratégie, La dynamique entrepreneuriale sur 2000-2022 : y-t-il une spécificité française ?.
6 Selon l’INSEE, une microentreprise est une entreprise occupant moins de 10 personnes, et qui a un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros.
7 INSEE, Les revenus d’activité des non salariés en 2022, INSEE Première n° 2012, 3 septembre 2024.
8 INSEE, Les entreprises en France, INSEE Références, 17 février 2025.
9 Voir notamment, Rapport de l’INSEE dit « Cotis », Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunération en France, 13 mai 2009 et INSEE, Le pouvoir d’achat du salaire net dans le secteur privé a progressé de 13,1 % entre 1996 et 2018. INSEE Focus, n° 230. 9 avil 2021.
10 Observatoire des inégalités, Comment évoluent la part des revenus captée par les plus riches ?, 24 février 2022.
11 DGFiP Analyses, Revenus et patrimoines des foyers les plus aisés en France, n°8, janvier 2025.
12 INSEE, L’essentiel sur la pauvreté, Chiffres clefs, 17 octobre 2024.