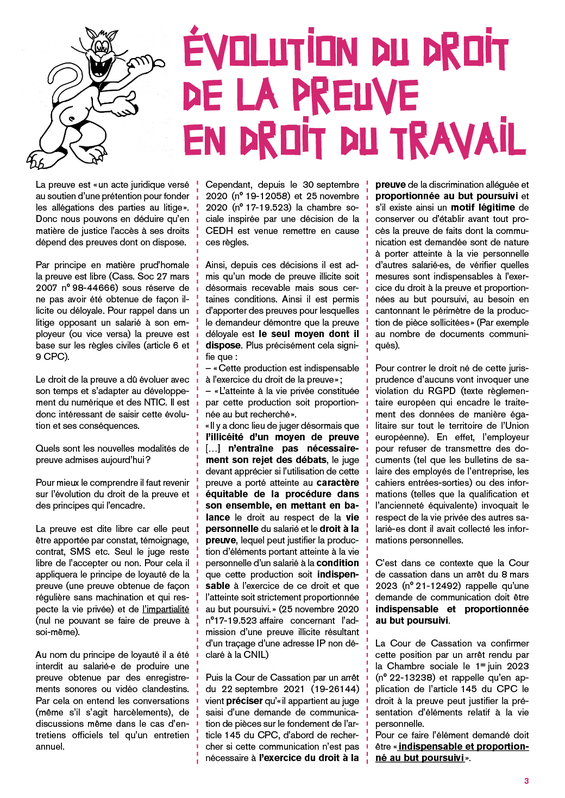La preuve est « un acte juridique versé au soutien d’une prétention pour fonder les allégations des parties au litige ». Donc nous pouvons en déduire qu’en matière de justice l’accès à ses droits dépend des preuves dont on dispose.
Par principe en matière prud’homale la preuve est libre (Cass. Soc 27 mars 2007 n° 98-44666) sous réserve de ne pas avoir été obtenue de façon illicite ou déloyale. Pour rappel dans un litige opposant un salarié à son employeur (ou vice versa) la preuve est base sur les règles civiles (article 6 et 9 CPC).
Le droit de la preuve a dû évoluer avec son temps et s’adapter au développement du numérique et des NTIC. Il est donc intéressant de saisir cette évolution et ses conséquences.
Quels sont les nouvelles modalités de preuve admises aujourd’hui ?
Pour mieux le comprendre il faut revenir sur l’évolution du droit de la preuve et des principes qui l’encadre.
La preuve est dite libre car elle peut être apportée par constat, témoignage, contrat, SMS etc. Seul le juge reste libre de l’accepter ou non. Pour cela il appliquera le principe de loyauté de la preuve (une preuve obtenue de façon régulière sans machination et qui respecte la vie privée) et de l’impartialité (nul ne pouvant se faire de preuve à soi-même).
Au nom du principe de loyauté il a été interdit au salarié·e de produire une preuve obtenue par des enregistrements sonores ou vidéo clandestins.
Par cela on entend les conversations (même s’il s’agit harcèlements), de discussions même dans le cas d’entretiens officiels tel qu’un entretien annuel.
Cependant, depuis le 30 septembre 2020 (n° 19-12058) et 25 novembre 2020 (n° 17-19.523) la chambre sociale inspirée par une décision de la CEDH est venue remettre en cause ces règles.
Ainsi, depuis ces décisions il est admis qu’un mode de preuve illicite soit désormais recevable mais sous certaines conditions. Ainsi il est permis d’apporter des preuves pour lesquelles le demandeur démontre que la preuve déloyale est le seul moyen dont il dispose. Plus précisément cela signifie que :
– « Cette production est indispensable à l’exercice du droit de la preuve » ;
– « L’atteinte à la vie privée constituée par cette production soit proportionnée au but recherché ».
« Il y a donc lieu de juger désormais que l’illicéité d’un moyen de preuve […] n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. » (25 novembre 2020 n°17-19.523 affaire concernant l’admission d’une preuve illicite résultant d’un traçage d’une adresse IP non déclaré à la CNIL)
Puis la Cour de Cassation par un arrêt du 22 septembre 2021 (19-26144) vient préciser qu’« il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du CPC, d’abord de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salarié·es, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièce sollicitées » (Par exemple au nombre de documents communiqués).
Pour contrer le droit né de cette jurisprudence d’aucuns vont invoquer une violation du RGPD (texte règlementaire européen qui encadre le traitement des données de manière égalitaire sur tout le territoire de l’Union européenne). En effet, l’employeur pour refuser de transmettre des documents (tel que les bulletins de salaire des employés de l’entreprise, les cahiers entrées-sorties) ou des informations (telles que la qualification et l’ancienneté équivalente) invoquait le respect de la vie privée des autres salarié-es dont il avait collecté les informations personnelles.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 2023 (n° 21-12492) rappelle qu’une demande de communication doit être indispensable et proportionnée au but poursuivi.
La Cour de Cassation va confirmer cette position par un arrêt rendu par la Chambre sociale le 1er juin 2023 (n° 22-13238) et rappelle qu’en application de l’article 145 du CPC le droit à la preuve peut justifier la présentation d’éléments relatif à la vie personnelle.
Pour ce faire l’élément demandé doit être « indispensable et proportionné au but poursuivi ».
Nous pouvons donc en conclure que pour s’opposer à cette communication l’employeur a la possibilité de contester la proportionnalité de la demande.
Le moyen pour le/la salarié·e de pouvoir contrer cela sera d’apporter un début de preuve car il ne peut faire peser sur le défendeur (donc son employeur) l’administration de la preuve. En 2023 plusieurs décisions rendues par la Cour de cassation ont confirmé ce mouvement que beaucoup nomment « de libération du droit de la preuve en droit du travail ».
Si certain·es se réjouissent de cette évolution on peut en réalité y lire une volonté de rééquilibrer le droit de la preuve au profit de l’employeur puisque le/la salarié·e bénéficiait déjà d’exceptions tel que vol ou copie de documents de l’employeur.
D’ailleurs il est à noter que la jurisprudence est née de l’action d’un employeur qui cherchait à justifier le licenciement d’un salarié via un enregistrement clandestin (Cass.Ass.Plen22 décembre 2023 n° 20-20648) au nom du droit à la preuve. Dans cette affaire la cour considère la preuve comme recevable alors que l’employeur disposait d’autres moyens (comme tout simplement la non-exécution par le/la salarié·e de son contrat de travail ou la non-production du document demandé)
On peut légitimement se poser la question de disproportion de moyens dont dispose un employeur par rapport aux salarié·es.
Enfin, une question reste en suspend quant à la constitutionnalité d’une telle atteinte à la vie privée au nom du droit à la preuve.
Jusqu’ici les décisions rendues ont été obtenues à la suite de saisines d’employeurs donc attendons de voir comment les salarié·es utiliseront et s’approprieront ces jurisprudences.